Actualités

Paul BELARD en Roumanie
Un nouvel épisode de la saga de Paul Belard, toujours en verve. Paul nous décrit ici une vie américaine avec brio.

Me voici de retour aux USA après une escapade de près de deux ans en France. J’ai trouvé un travail dans une société filiale d’une firme française. Le patron est aussi le PDG de la société mère. Il ne me faudra pas longtemps pour comprendre que cette petite filiale est plus l’opportunité de fournir un job a sa petite amie qui a trente ans de moins que lui et qu’il a sans complexe nommé directrice. Mon titre est « Marketing Manager ». Il s’applique à des fonctions d’intermédiaire entre les sociétés américaines qui désirent exporter en Europe, principalement dans des sociétés de l’Est.
Le bureau est au sud de Manhattan, avec une belle vue sur le port. Le trajet de chez mes beaux-parents est d’environ une heure et demie, soit trois heures par jour. Le personnel est réduit, une dizaine de « misfits » qui n’ont pas l’expérience nécessaire, moi y compris, pour mener à bien la plupart des missions. Par exemple, un des employés est un ancien marchand de chapeaux qui a mis la clé sous la porte lorsque Kennedy a été élu président.
Sa façon de se présenter nu-tête a été le coup de grâce pour l’industrie chapelière américaine. Un autre, dont la seule qualification est de parler allemand, deviendra mon meilleur ami aux US. Repose en paix, my good friend Jacques Benbassat. Inutile d’aborder les compétences de la directrice ! Mais les aptitudes du patron qui est un ancien polytechnicien ont l’air de compenser les carences de son équipe puisque le chèque tombe régulièrement à la fin du mois.

Du côté personnel, la naissance attendue a lieu alors que mes beaux-parents nous hébergent toujours. Nous cherchons une maison. A la fin de l’année, nous en trouvons une à Greenlawn, une bourgade paisible a une demi-heure des parents de mon épouse. Elle rallonge de quelques minutes mes trajets en ville. Elle a un grand jardin et se situe en voiture à cinq ou six minutes de la gare. On achète aussi une voiture, une Chevrolet Monza, une des premières tentatives de l’industrie automobile américaine pour se lancer dans la fabrication de petites voitures.
Lorsque je fais remarquer au « dealer » que le pneu touche la carrosserie, j’aurais dû le planter là lorsqu’il résout le problème à coups de marteau ! Cette voiture a été un désastre constant. Au premier changement d’huile, le mécano oublie d’en remettre. Je remarque que la lampe huile est au rouge, mais c’est aussi celle du starter, une combinaison néfaste. Mais comme il fait très froid, cela ne m’alarme pas. Lorsque la voiture commence à bringuebaler, même réaction de ma part car il a neigé et la surface de la route est irrégulière. Finalement, le fracas est tel que je dois m’arrêter. Mon beau-père qui m’avait amené au garage et me suivait me rejoint, vérifie la jauge d’huile qui est sèche comme os laissé au soleil. On retourne au garage.
Que font-ils ? Ils refont le plein d’huile et m’assurent que tout ira bien. Apparemment, ils ne sont pas au courant de ce qui se passe lorsqu’un métal se frotte contre un autre sans lubrification. Il fallut les menacer de poursuite en justice pour qu’ils acceptent de changer le moteur et nous prêter une voiture. Plus tard, c’est la transmission qui a dû être remplacée, un problème qui n’arrive pratiquement jamais sur les voitures. Lorsqu’il pleuvait, des gouttes d’eau tombaient sur ma chaussure gauche. Je n’ai toujours pas compris comment l’eau arrivait à suivre le câble qui permettait d’ouvrir le capot et coulait dans l’habitacle. Bref, cette voiture était un désastre.

Les trajets aller-retour en train ne sont pas une perte totale de temps. Je veux devenir un « Professional Engineer ». Pour un client, cela signifie que vous avez les capacités nécessaires pour mériter sa confiance. Pour un employeur, cela indique une expérience élevée. Parmi vos collègues ingénieurs, elle intime le respect. Il faut dire que les américains ne considèrent pas les études faites dans d’autres pays d’un œil très favorable.
Je vais leur prouver le contraire ! Pendant des heures, je potasse les livres en anglais. Avec les normes du pays, ma plus grande difficulté est de me familiariser avec les unités tarabiscotées américaines.
Quel désastre que ce monument de la révolution française, le système métrique, soit ici pratiquement ignoré. C’est une épreuve difficile, mais je suis reçu à la première tentative. L’ingénieur qui travaille aussi au bureau l’a déjà tenté deux fois, et échoue une troisième. Les ingénieurs ici connaissent plus de choses sur une certaine matière, soit électriciens, mécaniciens ou autres.
L’enseignement de l’Enise étant plus large, plus généraliste, me permet de résoudre des problèmes en mécanique, électricité, hydraulique alors que l’ingénieur électricien américain ne peut que se concentrer sur les domaines spécifiques sa spécialité.

Les moments les plus intéressants de mon job sont les voyages en Roumanie. Plusieurs sociétés américaines souhaitent s’implanter là-bas et j’ai l’occasion d’y aller trois fois, en séjours de deux semaines. Le patron me file quelques tuyaux, notamment de mettre deux cartouches de cigarettes visibles dans ma valise. Il me prévient aussi de ne pas donner des dollars à qui m’accosterait dans les rues et, en général, de se méfier de quiconque voudrait engager une conversation. Tout cela me paraît un peu bizarre, mais bref, OK chef ! Lorsque l’avion atterrit à Bucarest, ses conseils prennent une autre tournure.
Quand l’avion touche le sol, j’aperçois par le hublot un blindé qui calque sa vitesse sur lui. Lorsque la porte s’ouvre, le véhicule est devant avec un bidasse tenant sa mitrailleuse jumelée braquée directement dessus. Charmant comité d’accueil ! A la douane, le préposé ouvre ma valise, voit les cigarettes, me jette un coup d’œil. J’acquiesce de signe de tête. Il s’octroie l’un des paquets qu’il place rapidement sous son bureau, file un coup de tampon sur mon passeport et me voilà officiellement en Roumanie.
A l’extérieur de l’aéroport, un choix s’impose entre les taxis légitimes et les non-officiels. Cela fait, je m’installe pour le trajet qui va m’amener à l’hôtel. Nous croisons pas mal de carrioles tirées par des ânes, puis entrons dans la ville par une avenue bordée d’immeubles en béton dans un style parfaitement communiste : gris, peut-être fonctionnels, mais d’une laideur et d’une uniformité à faire pleurer. Après les ânes et cette grisaille, je me demande dans quel hôtel je vais échouer.

A ma surprise, l’Intercontinental de Bucarest est l’antithèse de ce que je viens de voir, un magnifique bâtiment à l’architecture moderne très attrayante. La chambre est spacieuse et confortable, avec une vue imprenable sur les environs. C’est la bâtisse la plus haute de la ville, qui, vue de si haut, n’a pas mauvaise allure. Mais une vielle romanichelle pied nus qui nettoie des abords du bâtiment avec un balai fait de brindilles, comme celui dont mon oncle dans le Cantal se servait pour décrotter l’étable, illustre les inégalités qui règnent en Roumanie sous le poing de fer de Ceaucescu, un sbire de Moscou. Comme il se doit à tout tyran digne de ce nom, il vit dans un grandiose palais, avec une suite de sycophantes et une armée pour le protéger de l’éventuelle colère d’une populace négligée.
Les devantures des boutiques sont pratiquement vides, mais certains restaurants, pour ceux qui peuvent se le permettre, sont excellents. Portions de caviar, esturgeons, vins blancs honnêtes (les rouges sont insipides) vont sur mes notes de frais. Les petits-déjeuners à l’hôtel sont l’équivalent de ceux servis en Amérique. Un matin, je prends une orange au cas où une petite faim se ferait sentir au bureau. Lorsqu’elle l’aperçoit, la secrétaire n’en croit pas ses yeux. Elle n’en a pas vue depuis des années. Lorsque je la lui tends, sa gratitude fait de la peine à voir. Les jours suivants, je lui apporte des bananes, des yaourts, des paquets de céréales, autant de choses qui lui sont soit interdites, soit inaccessibles. Ces actions sont les plus positives que j’accomplis en Roumanie. Lorsque j’apprendrai en 1989 l’exécution sommaire de Ceaucescu et de son épouse contre un mur, je repenserai au visage de cette jeune roumaine lorsque je déballais ces trésors de mes poches. J’espère sincèrement que sa vie est meilleure.
Du côté professionnel, pas tellement de succès. Toutefois, cette filiale roumaine représente la firme Hennessy. Je ramène toujours une bouteille de cognac à la fin de mes séjours. En plus, je fais toujours une escale à Paris sur le chemin du retour pour voir une partie de la famille, car cela n’augmente pas le prix de ticket d’avion.

Evidemment, dans ces conditions, la société vivote. Je soupçonne le patron de siphonner des fonds de la maison mère pour la garder à flot. Mais combien de temps cela peut-il durer ? Pas plus de deux ans pour moi et quelques autres. Un matin, réunion d’urgence. Le patron explique la situation : la moitié du personnel est renvoyée. Là je découvre des conséquences que je n’avais pas imaginées. Aux USA, ce sont les sociétés qui fournissent les couvertures sociales.
Renvoyés, vous vous retrouvez sans assurance maladie du jour au lendemain. En plus, lorsque vous retrouvez un travail, la couverture ne commence que trois mois après la date d’embauche. Ce n’est pas le moment d’avoir une péritonite aiguë, sans salaire et pour faire face aux tarifs outranciers des toubibs du pays ! Au moins, l’Etat de New York donne une allocation chômage. Ce n’est pas le cas dans tous les Etats. Quelle humiliante démarche d’aller chaque semaine toucher cette maigre pitance, attendre en file avec d’autres rejetés pour un temps de la société, d’être appelé par une préposée qui vous demande d’abord de lui fournir les preuves que vous cherchez activement un travail.
J’ai répondu à une annonce dans le journal d’une société d’ingénierie dans le Connecticut qui recherche un ingénieur. Je reçois bientôt une lettre me confirmant que ma demande est rejetée. Deux jours plus tard, un coup de fil d’un chef de service de cette même société me convoque pour une interview. Bon la main droite ignore ce que fait la main gauche dans cette boîte. Est-ce un bon signe ? L’interview est positive. Je suis embauché comme process ingénieur, ce qui consiste à sélectionner les équipements nécessaires pour satisfaire les besoins de la fabrication d’un produit. Je suis resté trois semaines sans travail, et personne n’est tombé malade dans la famille, ce qui n’est pas mal.
Le travail est intéressant, les allers et retours le sont moins. La société est à Stanford, à une heure et demie en voiture s’il n’y a pas trop de bouchons. On envisage un moment avec mon épouse de déménager ; c’est une bonne chose qu’on ne l’ait pas fait comme on le verra. Par chance, il y a d’autres employés qui habitent à Long Island et je rejoins un « carpool » où nous prenons notre voiture à tour de rôle, économisant ainsi de l’essence.
Une Toyota Starlet a remplacé la Monza. Elle est petite mais marche bien et est économique. Me voilà tiré d’affaire. Mais est-ce bien le cas ? Non, des situations bien pire se profilent à l’horizon.
Mais je l’ignore encore, et comme on dit ici « ignorance is bliss », l’ignorance est le bonheur.

 2
2












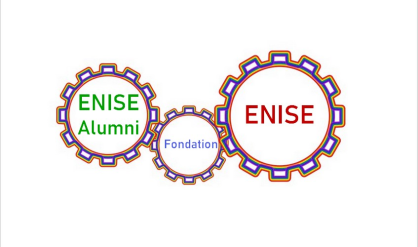
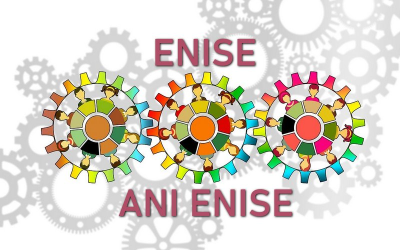




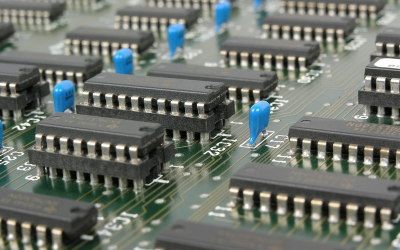





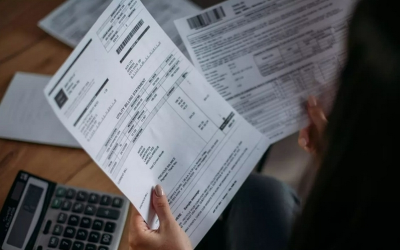

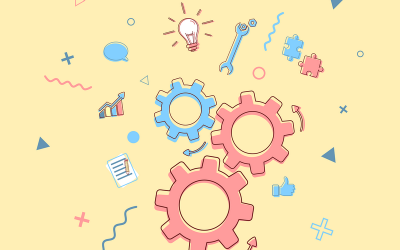


Aucun commentaire
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.