Actualités

Un éniséen à Detroit
La news concernant l'ENISE Flash chez Michelin de janvier 2022 a eu un grand succès auprès des éniséens,
Paul Bélard nous propose aujourd'hui la suite, c'est à dire son arrivée aux Etats Unis et son premier emploi.
Vivre une expérience à l'étranger est devenue fréquente de nos jours et nécessaire pour obtenir son diplôme d'ingénieur, il faut maintenant 6 mois de mobilité internationale en plus du TOEIC mais en 1975 c'était un beau challenge.

"Juste avant Noël 1975, mon épouse et moi avons quitté la France. Des six années qui avaient suivi ma sortie de l’Enise, une avait été dédiée dans l’Armée de l’Air (en 1970, la durée du service était passée de deux ans à douze mois, ô joie !), les suivantes chez Michelin, à Clermont-Ferrand. Malgré un départ un peu amer sur lequel je reviendrai, ces cinq ans ont été somme toute bénéfiques.
Non seulement, j’y ai acquis une expérience que peu de sociétés offrent à un jeune ingénieur, mais en outre, j’y ai rencontré ma future épouse, Dorothy, une américaine venue faire un stage à Clermont pour s’imprégner de « L’esprit Michelin. »
Nous résidions chez mes beaux-parents, dans une petite ville de Long Island à une cinquantaine de kilomètres de New York City. Une fois les fêtes de Noël et du jour de l’an terminées, je commence à consulter les annonces d’emplois dans les journaux locaux. J’en entoure une qui semble prometteuse, celle d’une compagnie qui recherche un ingénieur parlant le français.
Malgré la présence d’un numéro de téléphone, j’y réponds par écrit. Après tout, je ne suis qu’un émigré dans ce pays, mon accent et un anglais encore imparfait ne constituent pas exactement des atouts. Une lettre et mon CV me semblent plus appropriés. Deux jours plus tard, par un simple coup de téléphone, je suis convoqué pour une interview.
Première semaine de janvier 1976. En sortant de la gare de Penn Station à Manhattan, j’arpente les trottoirs enneigés pour me rendre à cette convocation. Une secrétaire me guide à travers un bureau d’études parsemé de planches à dessin et de pupitres en partie cachés par des piles de calques et bleus. L’homme qui m’accueille dans une salle de conférence a un accent pire que le mien, mais il s’exprime dans un anglais très compréhensible. Il m’enjoint de m’asseoir et passe quelques minutes à consulter la page de mon CV. Il me pose quelques questions dont j’ai franchement oublié la teneur. Celle dont je me souviens très bien est « Suis-je prêt à aller à Chicago pour six mois ? ». Je réponds probablement, mais j’aimerais en discuter avec ma femme. Il me montre un téléphone et me laisse seul. Dorothy n’est pas particulièrement emballée par cette possibilité, elle comptait reprendre sa place chez Michelin à Long Island. Mais elle me laisse la décision.
L’homme revient. Je lui donne mon accord. Il m’explique que la société Union Carbide va construire une usine en France et que mon job consistera à adapter les dessins américains aux normes françaises, et notamment à modifier les machines pour passer de la fréquence américaine de 60 hertz à l’européenne de 50 hertz. Ensuite, il me propose un salaire de $20,000 par an et me demande quand je peux partir. Je suis un peu dépassé par la rapidité de cette proposition.
Je suis aux Etats-Unis depuis moins de deux semaines et dans ce bureau depuis vingt minutes et j’ai déjà décroché un emploi. Pas de tests psychologiques pour déterminer les traits cachés de ma personnalité, pas de rendez-vous échelonnés sur plusieurs heures, voire jours. Cette embauche extra rapide m’émerveille. Quel pays ! Il me faudra plusieurs années pour découvrir qu’un emploi peut y être perdu en encore moins de temps, mais c’est une autre histoire.

Les deux journées suivantes sont passées à préparer le voyage. Ma femme a une Camaro, une voiture racée rouge. On y entasse les bagages. Je suis excité par cette aventure, mon épouse l’est beaucoup moins.
Après être sortis des agglomérations de la côte est, le cheminement vers l’Amérique profonde devient d’une fadeur à mourir d’ennui. L’autoroute est recouverte de béton ; les pneus claquent sur les joints avec la régularité d’un métronome. Le paysage est plat à perte de vue. Seuls des silos à grains et des clochers d’église émergent par-ci, par-là.
Heureusement, ce que je considère de très loin comme le meilleur cadeau de l’Amérique au reste du monde est à la portée d’un tour de bouton : sa musique. Jazz, gospel, blues, dixieland, rock & roll, country & western, ces genres ont déferlé à travers la terre plus rapidement que ses armées et de façon beaucoup plus durable. Je cale la radio sur une station country. Je dois en changer quand les kilomètres rendent ses signaux trop faibles.
Plus on s’éloigne, les radios deviennent de plus en plus religieuses avec sermons et compagnie. La nuit est passée dans un de ces motels vétustes qui bordent les grandes voies. La télévision est boulonnée à une chaîne, les encadrements ont des vis aux quatre coins, le radio-réveil semble cloué sur la table de nuit. Il est vrai que, comme il n’y a qu’une porte entre nous et la voiture, la prudence s’impose ! Il a neigé pendant la nuit.
Pas besoin de sortir pour le remarquer, elle s’est infiltrée sous la porte et a blanchi la moquette sur une vingtaine de centimètres. La neige n’a pas tenu sur l’autoroute et le trajet se poursuit sans histoire. On arrive à Chicago autour de midi. Là, je commence à avoir une idée de l’immensité de ce pays. Si nous avions quitté Paris à la même heure que New York, on serait arrivé à Berlin il y a déjà deux heures.
L’Holiday Inn où nous avons une réservation est dans le centre sud de la ville. On se perd un peu, pas de GPS à l’époque. La population du quartier est composée en majorité de noirs et d’hispaniques. Le nombre de serrures, de verrous et autres loquets de sûreté qui s’alignent le long de la porte de la chambre nous intrigue un peu. Je passe un coup de fil à la personne que j’ai vue à New York pour l’informer de notre arrivée. Il me demande où nous sommes. Ma réponse l’abasourdit. « Quittez cet endroit, il est mal famé. Je vous réserve une chambre à l’Holiday Inn près du lac au nord de la ville. » L’hôtelier est tout aussi surpris de nous voir le quitter si vite.
Le quartier où nous aboutissons est nettement plus cossu. La chambre est plus grande, le lit plus large, la moquette plus épaisse, les vues accrochées aux murs plus artistiques. Si les employés sont aussi des gens de couleur, la clientèle est franchement blanche. Un excellent dîner est pris dans le restaurant rotatif du sommet de l’immeuble. Les vues sur la ville et le lac Michigan sont fantastiques.
Le lendemain matin, un lundi, Dorothy me dépose au bureau qui est dans le centre-ville. Je lui souhaite une bonne journée et pénètre dans mon nouveau lieu de travail. C’est un bâtiment sans prétention, de deux niveaux, avec de grandes baies vitrées. A première vue, le bureau d’études n’est pas différent d’un espace similaire chez Michelin, bureaux et planches à dessin éparpillés, au deuxième étage.
A propos, il n’y a pas de rez-de-chaussée aux Etats-Unis. Bien sûr, architecturalement, il existe, mais ici, il s’appelle first floor, premier étage, parfois ground floor, l’étage au niveau du sol, mais notre second est ici le premier. Une seconde observation me permet de remarquer que les planches à dessin sont équipées de règles parallèles, maintenues de chaque côté par des câbles métalliques, qui coulissent à volonté en restant strictement parallèle aux bords supérieur et inférieur de la table.
Toutes les planches que j’ai connues en France sont équipées de règles en équerre fixées à des parallélogrammes qui permettent de couvrir la totalité de la planche très rapidement. Beaucoup plus pratique ! C’est un détail qui semble anodin, mais si dans beaucoup de domaines, ce pays est en avance sur la France, dans d’autres il est en retard de cinquante ans, mais j’y reviendrai.
Pendant cette journée, je suis initié à certaines règles, horaires, tenues (cravate obligatoire), assurance maladie et retraite. Première différence avec la France : assurance et retraite sont à la charge de l’employeur.
Etant jeune, en bonne santé, et un peu insouciant de l’avenir, il me fallut un certain temps pour en assimiler les conséquences. Elles ne sont pas plaisantes. On perd son emploi, donc son salaire, on se retrouve aussi sans assurance maladie. La compagnie fait faillite, le montant mis de côté pour la retraite risque de s’évanouir. A l’occasion de futurs emplois, je devrai faire face à ces deux circonstances. Mais cela sera le sujet de prochains chapitres".
 2
2








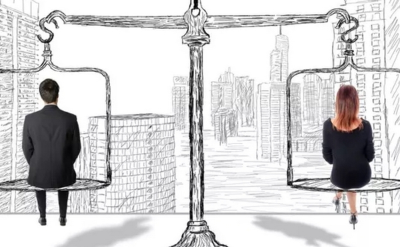









2 Commentaires
Merci pour ce morceau de mémoire où je reconnais ton style précis et épuré. Tu me donnes l'envie de raconter mon expérience un peu de la même façon. Ma mère sur ses vieux jours dormait mal, se réveillait dans la nuit et nous disait: " je fais les films de ma vie dans ma tête et si je pouvais les projeter au plafond ce serait formidable". Hé bien avec clarté et concision, j'ai un peu l'impression de voir les images suivant le scénario que tu déroules au fil des paragraphes.
On a fait des films avec moins que cela!
J'ai hâte de connaître la suite pour comparer un peu avec mes stages en Angleterre en juillet 72 et 73 alors que je crois que personne n'était jamais sorti de l'hexagone pour travailler en tant qu'étudiant de l'Enise. Et BOUM! les souvenirs s'accumulent...
A bientôt et bonne santé à toute la famille.
Je dois reconnaître que le titre de l'article « eniseen à détroit » m'a attiré puisque je suis moi même dans la région de détroit. Pas tout à fait le même parcours puisque j'ai commencé par la Californie il y'a 18 ans et détroit (rochester hills) depuis 6-7 ans. Et la ferme au écrevisse ? Je suis intéressé !
Michael promo 98-2003
Vous devez être connecté pour laisser un commentaire. Connectez-vous.